du télescope de Newton






Les
cotes indiquées ici ne sont bien sûr valables que dans notre
cas. Il faut les adapter à chaque fois. Cependant les ordres de
grandeur doivent être les mêmes (en cas de difficultés
nous consulter).
Les plans donnés ci-dessous
peuvent être adaptés à des télescopes dont le
diamètre du miroir primaire est inférieur ou égal
à 200mm. Pour des diamètres supérieurs à 250mm
il faut prévoir un montage différent du miroir dans le barrillet
(leviers astatiques) et un autre type de monture... à poste fixe
(monture à berceau). Ce genre d'instrument sort probablement du
cadre d'un projet réalisable dans une école primaire.
Le télescope se construit en règle générale autour de son miroir primaire. On construit d'abord le barillet, puis le tube autour du barillet, puis la fourche autour du tube et enfin le pied. Il vaut mieux éviter un ordre différent... C'est la construction du tube qui demande le plus de soin. Lorsque cette étape est franchie le reste du projet doit pouvoir être conduit sans problèmes majeurs.
Le télescope décrit ici est un télescope de type Newton, c'est-à-dire que le foyer du miroir primaire est rejeté sur le côté du tube à l'aide d'un miroir plan elliptique pour permettre l'observation. La monture est de type équatoriale à fourche. Equatoriale pour permettre l'observation des astres en faisant tourner l'instrument autour d'un axe qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. La rotation s'effectue à la vitesse de rotation de la Terre (un tour par jour sidéral) mais en sens opposé. La monture à fourche est probablement la plus simple à construire avec des moyens de base. Elle est solide, légère, d'un encombrement réduit et facilement démontable ce qui facilite son transport vers des ciels plus propices aux observations astronomiques que le ciel des villes.
Rappelons que l'ensemble du
projet a été mené à bien par une classe de
cycle III (CM2) en moins de deux mois. Seule l'utilisation de la scie sauteuse
est à réserver à l'enseignant pour des raisons évidentes
de sécurité. Les trous peuvent être effectués
par les enfants, sous contrôle de l'enseignant, à l'aide d'une
perceuse montée sur colonne fixe.
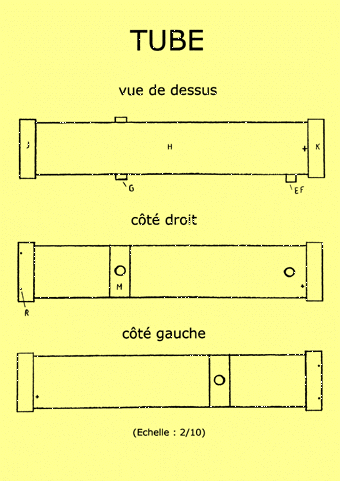 |
La longueur L des parois du tube est avant tout
fonction de la distance focale F du miroir primaire. Il faut aussi tenir
compte d'un certain nombre d'autres paramètres :
La longueur des panneaux du tube est alors: Leur largeur est donnée par les dimensions du barillet. Elle vaut 155mm dans notre cas. Les pièces aux extrémités du tube sont destinées à le rigidifier. L'axe de déclinaison est environ au tiers de la longueur du tube à partir du barillet. |
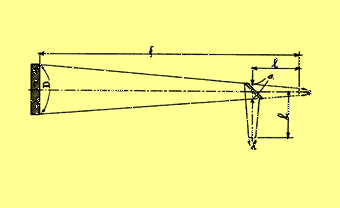 |
Cette figure correspond à la vue de dessus
du cadre précédent.
|
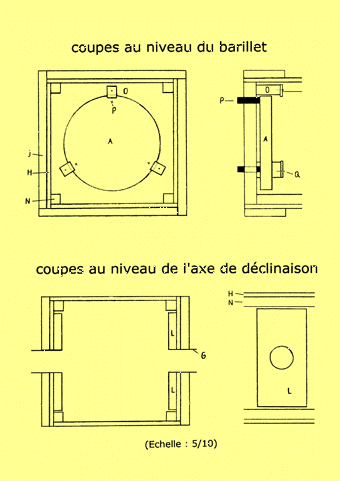 |
Les dimensions du barillet sont dictées par le diamètre du miroir primaire. On doit y ajouter la dimension des trois blocs d'appuis à 120°. Le mieux est de faire un plan sur papier millimétré, il faut juste un compas et une règle. Dans notre cas nous avons trouvé que le fond du tube devait mesurer 150mm de côté. |
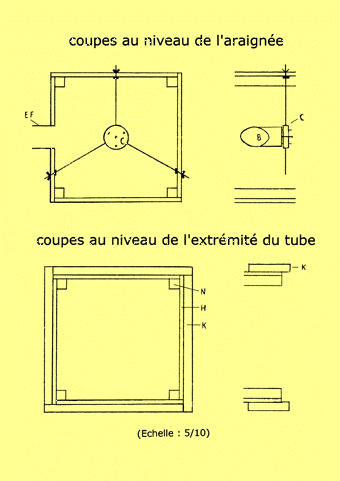 |
Remarquer le montage des panneaux du tube et des renforts d'extrémité. D'un point de vue optique une araignée à quatre branches aurait été préférable mais celle que nous avons trouvée était très abordable financièrement... et c'était aussi un des rares modèles disponibles. |
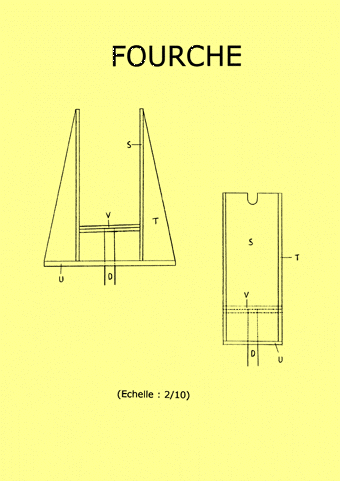 |
La construction de la fourche ne pose pas de problèmes particuliers. Il faut simplement se souvenir que le tube doit pivoter librement à l'intérieur des bras. La barre en acier (diamètre 30mm) qui sert d'axe horaire doit entrer sans jeux dans les trous percés dans la planche notée U et l'une des planches notées V (l'autre planche V sert de butée d'axe horaire). Les deux bras de la fourche doivent être rigoureusement parallèles entre eux et bien perpendiculaires à la base de la fourche notée U. |
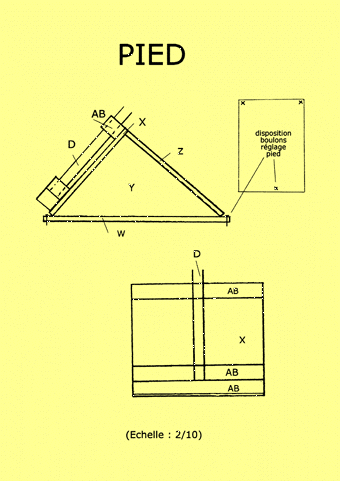 |
La construction du pied ne présente pas non plus de problèmes particuliers. Le pied a été construit pour que le télescope puisse observer à une latitude proche de 49° c'est à dire en région parisienne. Pour une autre région de France on peut soit soulever ou baisser légèrement l'axe polaire afin qu'il reste parallèle à l'axe de rotation de la Terre soit découper les triangles en fonction de la latitude du lieu d'observation. Trois boulons permettent les réglages fins de l'inclinaison de l'axe horaire. |
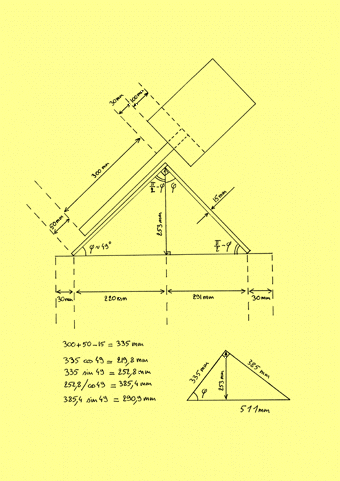 |
La figure ci-contre n'est pas à l'échelle.
|
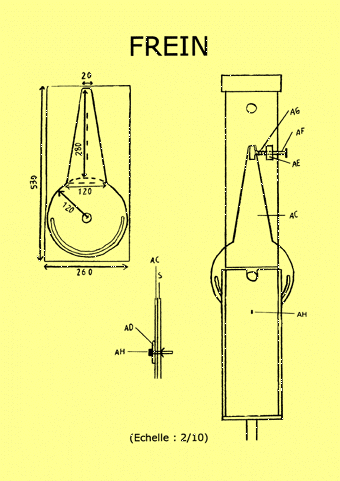 |
La pièce décrite ici fait à la fois office de frein et de mouvement lent en déclinaison. Elle pivote librement autour de cet axe. Un tige filetée dont l'axe est perpendiculaire à l'axe optique du télescope fait pivoter le tube dans un sens lorsqu'on la visse dans l'écrou en bois qui est collé sur l'une des parois du tube et dans l'autre sens, avec l'aide d'un ressort de rappel, lorsqu'on la dévisse. Pendant ces opérations la "raquette" est rendue solidaire du tube par l'intermédiaire d'un boulon. |